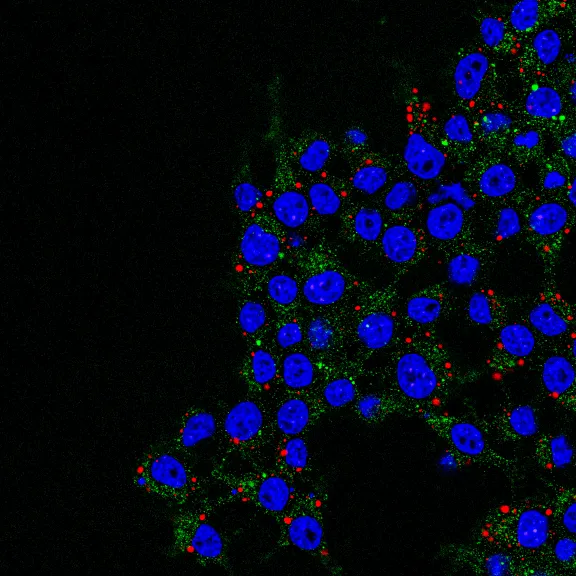« Grâce à ATIP-Avenir, de talentueux chercheurs choisissent la France pour poursuivre leur carrière » Grand entretien avec Hugues de Thé, président du conseil scientifique de la Fondation



La Fondation vient de fêter les 20 ans de son soutien au programme ATIP-Avenir destiné à inciter de jeunes chercheurs à s’installer en France pour monter leur propre équipe. Président du conseil scientifique de la Fondation, Hugues de Thé nous présente les enjeux de cet accompagnement, et son rôle dans l’engagement plus global de la Fondation pour les sciences de la vie.
La Fondation accompagne le programme ATIP-Avenir depuis 20 années. Pouvez-vous nous présenter ce programme ? Combien de chercheurs concerne-t-il ? Et quel est leur profil ?
Le programme ATIP-Avenir a été fondé par l’Inserm et le CNRS pour inciter des jeunes scientifiques à s’installer en France, pour y créer leurs équipes. Il peut s'agir de chercheurs étrangers ou de Français partis, notamment en postdoc en Europe ou en Amérique du Nord. Pour répondre à cet objectif, ATIP-Avenir agit sur deux leviers. D’une part, il alloue à ces chercheurs un salaire qui leur permet d’intégrer un laboratoire CNRS ou Inserm, s’ils n’ont pas encore été recrutés par un organisme français. D’autre part, il offre à ceux qui sont déjà en poste la possibilité de fonder une équipe dans des conditions relativement privilégiées, notamment en termes de financement… Ce programme s’est construit en marchant, avec un nombre plus ou moins important de chercheurs selon les années. Il concerne aujourd’hui une vingtaine de scientifiques par an. Les financements sont attribués pour trois à cinq ans et sont dédiés aux sciences de la vie, mais dans une acception assez large. Dans ce programme, comme dans d'autres, il arrive à la Fondation de soutenir des chimistes ou des physiciens si leurs problématiques de recherche sont en rapport avec des sciences de la vie.
A-t-on des éléments d’évaluation de ce programme ?
ATIP a constitué une expérience très novatrice lors de sa création en 1990, donnant leur chance à de jeunes chercheurs alors que seuls des scientifiques dotés d’une solide expérience et d’un statut pouvaient à l’époque diriger une équipe de recherche en France. Autre aspect important, les dotations ATIP-Avenir* ont été attribuées par un jury international dès le lancement du programme, ce qui constituait une nouveauté et une façon d’élargir l’horizon. Aujourd’hui, on peut sans conteste affirmer qu’il s’agit d’un excellent programme en termes de qualité et de réussite des lauréats. Preuve de leur excellence, ceux qui n’ont pas encore de poste statutaire sont quasiment tous recrutés ensuite à l'Inserm, au CNRS ou à l'université. Autre élément clef d’évaluation, le taux de succès remarquable de ces lauréats aux appels d'offre du Conseil européen de la recherche (ang. ERC European Research Council). De mémoire, un tiers d’entre eux décroche ensuite un financement de l’ERC, ce qui est très supérieur à la moyenne française.
Pouvez-vous nous présenter quelques projets novateurs, qui ont directement profité de la dynamique ATIP-Avenir ?
Beaucoup d’entre eux sont également des lauréats de la Fondation. Je pense aux travaux de Paul Conduit qui a commencé sa carrière au Royaume-Uni avant de rejoindre l’Institut Jacques Monod à Paris comme chef d'équipe, pour s'intéresser à la nucléation des microtubules, sortes de squelettes qui organisent la forme et polarité de différents types cellulaires. Je pense aussi à ceux de Filipe Pinto Teixeira qui a travaillé dans différents pays avant de prendre la tête d'un laboratoire au Centre de Biologie Intégrative (CBI) de Toulouse qui aborde l'organisation des circuits neuronaux chez la mouche.
La Fondation accompagne ATIP-Avenir depuis 20 ans. Quelle est la nature de ce soutien ?
Celui-ci a évolué au fil des années. La Fondation a commencé par financer un lauréat supplémentaire, dans les mêmes conditions que celles de l’Inserm et le CNRS. Les choses ont ensuite évolué et elle alloue désormais chaque année une dotation supplémentaire, une forme de bonus de 300 000 €, à l’un des chercheurs. Elle entend ainsi jouer un rôle d’accélérateur pour un projet auquel elle croit particulièrement. Le lauréat est choisi par le conseil scientifique de la Fondation selon une procédure assez classique. Nous étudions les dossiers de tous les candidats et retenons, après audition de 3 à 4 d'entre eux, le projet qui nous semble le plus intéressant, le plus original, le plus prometteur.
Comment ce projet s’inscrit-il dans l’engagement plus général de la Fondation pour les sciences de la vie ?
Le motto de la Fondation est toujours le même... Donnons des ailes aux talents, et donc identifier ceux qui doivent être soutenus, car ils peuvent aller plus haut, et plus vite. Ce bonus, alloué à un candidat au moment crucial où il est en capacité de fonder une équipe et se lancer dans une recherche indépendante, est parfaitement en ligne avec cet objectif. C’est dans cet esprit que la Fondation a également lancé le programme Impulscience, destiné cette fois à soutenir, de manière substantielle et pendant 5 ans, des chercheurs en milieu de carrière. Des scientifiques qui ont déjà eu une expérience de chef d'équipe et ont besoin d’un coup de pouce pour poursuivre ce qu'ils ont débuté. Par ailleurs, rappelons que la Fondation croit davantage aux femmes et aux hommes, qu’aux structures. C'est l’une de nos constantes de chercher à promouvoir des profils exceptionnels dans le domaine des sciences de la vie avec toujours le même objectif, améliorer la santé humaine à travers la recherche fondamentale.
La Fondation propose également des événements qui réunissent les chercheurs qu'elle accompagne, la journée anniversaire des 20 ans d’ATIP-Avenir par exemple. Dans quel esprit sont pensées ces rencontres ?
Cette politique d’accompagnement est un axe fort que nous développons depuis deux ou trois ans, via des événements réguliers. L'an dernier, nous avons proposé une journée autour de la créativité et de la manière dont naissent les idées, en sciences comme en art ; un moment très riche qui a rassemblé à la fois des chercheurs et des artistes. Le 10 juillet dernier, nous avons organisé un événement pour célébrer les 20 ans d’accompagnement au programme ATIP-Avenir. Le temps d’une journée, des lauréats de niveau de carrière très différents ont pu témoigner de leur expérience, et du rôle clé du programme dans leurs recherches. Je pense notamment aux échanges passionnants entre Nathalie Vergnolle, directrice de recherche à l’Inserm et directrice de l’Institut de Recherche en Santé Digestive à Toulouse et lauréate ATIP-Avenir en 2006 et Meryem Baghdadi, chargée de recherche CNRS, cheffe d’équipe "Stem Cell Niche and Development", à l’Institut Necker Enfants malades à Paris et lauréate ATIP-Avenir 2024, presque 20 ans plus tard. Une occasion unique de partage et de mise en perspective…
Dans le même temps, des conférences ont permis de réfléchir ensemble aux sujets cruciaux pour la communauté scientifique, notamment celle menée par l’épidémiologiste Mathilde Touvier (à l’origine du Nutri-score) sur la façon dont la recherche peut déboucher sur des politiques publiques. Avec ces rencontres, notre objectif est de constituer un réseau des lauréats qui leur offre l’opportunité de découvrir d’autres disciplines, d’échanger autour de leur expérience et pourquoi pas, de nouer des partenariats scientifiques.
Après cet anniversaire, comment la Fondation va-t-elle prolonger son accompagnement à ATIP-Avenir ?
Le soutien va se poursuivre dans les mêmes termes, en s’adaptant aux ajustements éventuels que l'Inserm et le CNRS souhaiteraient apporter à ce programme. ATIP-Avenir est un programme de très grande qualité, et il nous semble d’autant plus essentiel dans le contexte géopolitique que nous connaissons aujourd’hui, alors que de nombreux jeunes chercheurs travaillant Outre-Atlantique et notamment ceux d'origine européenne, sont très préoccupés et réfléchissent sérieusement à leur retour en Europe et en France.
*Création du programme Avenir en 2005, puis ATIP-Avenir en 2009