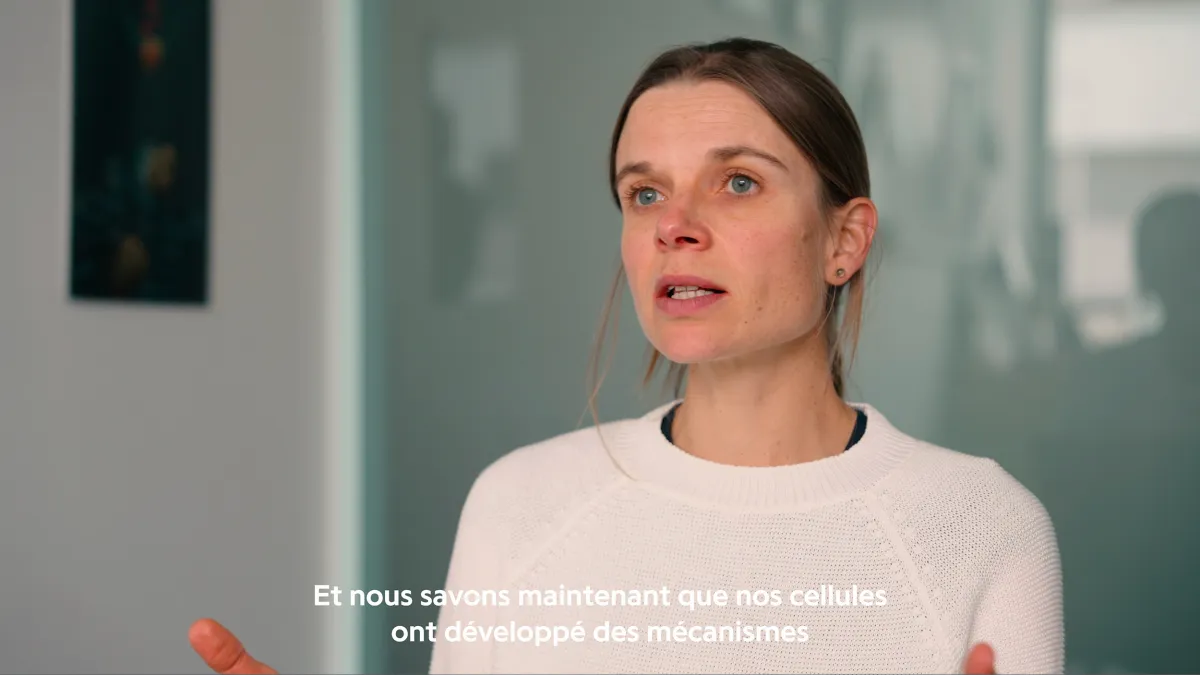« Nous vivons une période passionnante, où recherche et ingénierie avancent main dans la main » Entretien avec Andrea Ablasser, Professeure et cheffe du laboratoire « Immunité innée » au Global Health Institute de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Lauréate du Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant 2024, la chercheuse allemande Andrea Ablasser est aujourd’hui l’une des scientifiques les plus influentes dans le domaine de l’immunologie. Elle revient sur la nature de ses travaux et l’impact de cette distinction, un an après son attribution.
Vous avez étudié la médecine avant de vous consacrer à la recherche. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre parcours et des principales motivations qui ont guidé ce choix ?
Au lycée, j’étais très attirée par les sciences, ce qui m’a naturellement conduite à me diriger vers la médecine que j’appréhendais principalement sous un angle scientifique. J’étais fascinée par le fonctionnement du corps humain, par la façon dont les maladies apparaissent. Peut-être ai-je aussi été influencée par mon père, qui était médecin. Au cours de mes études, j’ai compris que ce qui me passionnait vraiment n’était pas seulement le traitement des maladies mais aussi la compréhension de leurs mécanismes. Cette envie de comprendre comment les pathologies émergent et comment elles peuvent être surmontées m’a finalement menée vers une carrière dans la recherche biomédicale.
Vous travaillez aujourd’hui avec votre équipe sur le système immunitaire inné. Pouvez-vous nous présenter ce domaine ?
L’immunité innée constitue la première ligne de défense de notre organisme contre les infections. Elle repose sur un ensemble de capteurs cellulaires capables de détecter les virus ou bactéries envahissants, et de déclencher des réponses inflammatoires protectrices. Ce système est essentiel à notre survie, mais sa précision et sa régulation le sont tout autant. Une activité trop faible nous rend vulnérables aux infections, une activation excessive peut provoquer une inflammation et des lésions tissulaires.
Ce type d’immunité nous protège contre les virus et les bactéries, mais il présente donc, parfois, des défaillances. Quels sont les mécanismes impliqués dans ces dysfonctionnements, et quelles en sont les conséquences ?
Notre système immunitaire doit maintenir un équilibre délicat : éliminer efficacement les agents pathogènes, tout en limitant les dommages collatéraux à nos propres tissus. Dans la plupart des cas, cet équilibre est assuré par des mécanismes régulateurs qui agissent en arrière-plan, pour éviter une activation excessive ou prolongée. Mais lorsque cette stabilisation (qu’on appelle homéostasie) est perturbée, par exemple lors d’une maladie ou du vieillissement, ces systèmes de contrôle peuvent faillir. Le résultat est souvent une réponse immunitaire anormale ou dirigée contre soi-même. Cette régulation insuffisante de l’immunité se trouve au cœur de nombreuses maladies humaines, des troubles auto-immuns et métaboliques aux affections neurodégénératives et liées à l’âge.
Depuis 2013, vos publications marquent des étapes clés dans votre compréhension du système immunitaire. Pourriez-vous retracer les grands moments de ce parcours scientifique ?
Nos travaux ont contribué à définir les composants essentiels d’un système de détection immunitaire, appelé voie cGAS-STING, qui nous protège contre une large gamme d’agents pathogènes. Observation fascinante, ce système immunitaire peut être retracé jusqu’à des mécanismes de défense bactériens apparus il y a des milliards d’années. Nous avons ensuite découvert que cette même voie détecte aussi d’autres formes de détresse cellulaire, comme la transformation cancéreuse ou les dommages liés au vieillissement. Elle pourrait même participer à l’inflammation chronique de bas grade qui accompagne le vieillissement et favorise plusieurs maladies associées à l’âge.
En cherchant à mieux comprendre l’importance physiologique de cette voie, nous nous sommes aussi beaucoup intéressés à sa régulation en conditions normales, et à la manière dont cette compréhension pourrait inspirer de nouvelles approches thérapeutiques. Avec mon équipe, nous avons identifié de petites molécules capables d’inhiber l’activation de ce mécanisme de signalisation – des découvertes qui ont déjà inspiré des essais cliniques pour traiter certaines maladies inflammatoires. Plus récemment, nous avons commencé à appliquer des principes d’ingénierie aux protéines immunitaires afin de révéler leurs mécanismes intrinsèques de régulation avec, pour objectif final, de mettre ces connaissances au service du développement de nouvelles thérapies anticancéreuses et de vaccins « nouvelle génération ».
Quelles stratégies thérapeutiques vos recherches permettent-elles d’envisager aujourd’hui ? Et quelles maladies pourraient, concrètement, être traitées grâce à ces avancées ?
Les recherches de notre groupe – mais aussi d’autres équipes – ont montré que la dérégulation de cette voie immunitaire contribue à un large éventail de maladies inflammatoires, notamment des troubles auto-immuns, des maladies neurodégénératives, certains cancers et des syndromes génétiques rares. Nombre de ces découvertes proviennent de modèles précliniques et, dans certains cas, de données issues de patients. Grâce à nos travaux de recherche translationnelle, nous avons appris qu’il est crucial d’identifier le bon contexte pathologique pour réussir le développement d’un médicament. Le choix de l’indication doit être à la fois scientifiquement solide et stratégiquement réfléchi. Ces recherches sont déjà très prometteuses et je pense qu’il existe de réelles opportunités de transformer ces connaissances en thérapies pour plusieurs maladies inflammatoires.
Vous avez reçu le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant en 2024. Comment percevez-vous cette récompense, et que vous a-t-elle apporté ?
Je suis profondément honorée que nos travaux aient été distingués par le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant. C’est une immense reconnaissance des efforts de mon équipe au cours de la dernière décennie. Ce Prix prend une grande valeur à mes yeux, il représente aussi un encouragement à poursuivre nos recherches fondamentales, avec l’ambition d’améliorer la vie des patients souffrant de maladies inflammatoires.
Vos travaux constituent des avancées majeures dans la compréhension de l’immunité innée. Quelles sont vos prochaines étapes ?
Nous nous intéressons de plus en plus à la combinaison de la biologie moléculaire et des principes de l’ingénierie pour mieux comprendre la logique régulatrice intrinsèque des capteurs immunitaires. En les disséquant et en les reprogrammant, nous espérons concevoir de nouvelles façons de moduler les réponses immunitaires – soit pour les renforcer, par exemple dans le cancer ou la vaccination, soit pour les inhiber en cas d’inflammation pathologique. J’ai le sentiment que nous vivons aujourd’hui une période passionnante, où la découverte fondamentale et l’ingénierie avancent main dans la main.
En savoir plus